Une déclaration des centres d’hébergement pour les femmes autochtones du Nouveau-Brunswick
La disproportionnalité des taux plus élevés de violence et du nombre de victimes observés chez les peuples autochtones est enracinée dans l’histoire traumatisante et destructrice de la colonisation qui a eu et continue d’avoir une incidence sur les familles autochtones. Le fait d’être victimes de violence a eu de profondes répercussions sur les Premières Nations en termes d’épanouissement social, économique et émotionnel. La méfiance à l’égard de la police et du système de justice pénale a une grande influence sur le signalement des violences faites aux femmes. Des générations d’Autochtones ont subi les conséquences négatives de la colonisation et de ses politiques ancrées dans la Loi sur les Indiens, et cette violence se poursuit de génération en génération.
Les femmes autochtones du Nouveau-Brunswick doivent avoir un accès égal et équitable à la sécurité et à la justice dans nos collectivités. Nous devons travailler avec tous les paliers de gouvernement pour élaborer des programmes et des services qui conviennent culturellement.
L’insuffisance du financement gouvernemental continue de constituer un obstacle systémique à la mise en œuvre de changements significatifs. Nous en appelons à la pleine mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les modèles de financement doivent viser à renforcer l’autodétermination des femmes autochtones plutôt qu’à fortifier les modèles coloniaux.
Le Nouveau-Brunswick doit prendre immédiatement des mesures significatives pour s’attaquer aux enjeux systémiques qui ont rendu possible la violence contre les femmes autochtones.
-Centre d’hébergement pour femmes Nignen et Maison de transition Gignoo


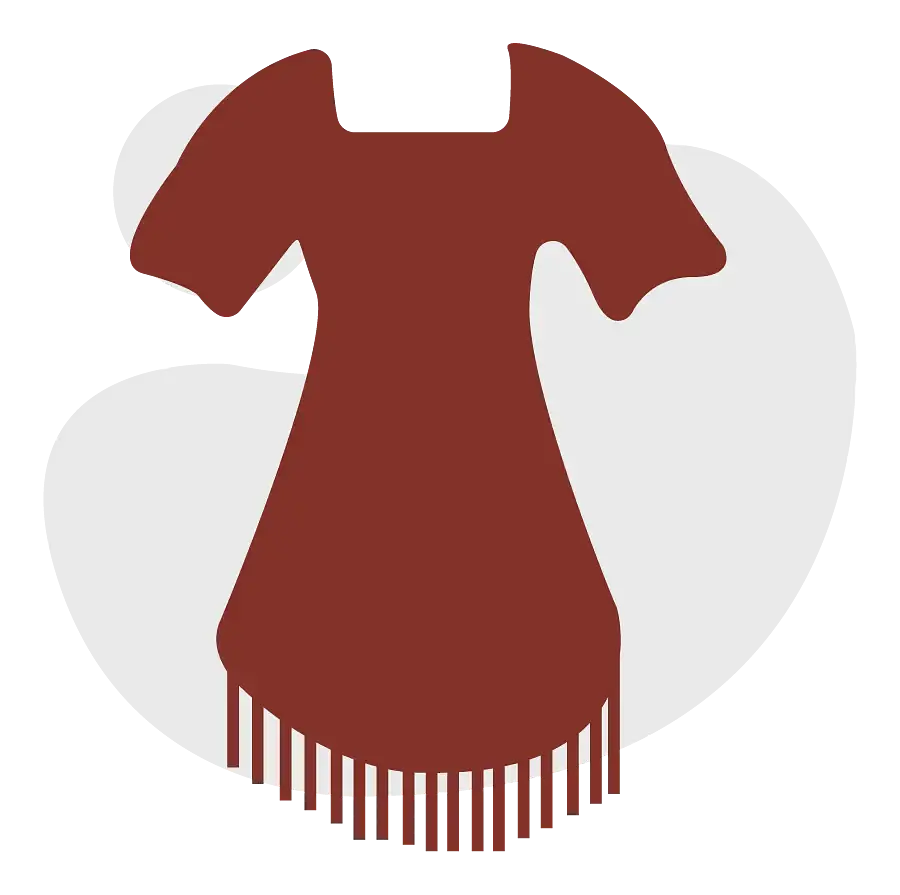
Violence à l’encontre des femmes autochtones
Bien qu’elles ne constituent qu’environ 5 % de la population féminine au Canada (Statistique Canada, 2021), les femmes autochtones subissent des taux de violence parmi les plus élevés.
On présente ci-dessous des résultats tirés de « La violence entre partenaires intimes : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada » (2018) par Loanna Heidinger, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, un article basé sur des données autodéclarées de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés (ESEPP) de 2018. Vous pouvez lire l’article complet ici.
Les femmes autochtones subissent tous les types de violence entre partenaires intimes à des taux plus élevés.
Les femmes autochtones (61 %) sont plus susceptibles de subir une forme ou une autre de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie (à compter de l’âge de 15 ans) que les femmes non autochtones (44 %).
Les violences physiques et sexuelles sont souvent considérées comme des formes plus graves de violence entre partenaires intimes. Une proportion nettement plus élevée de femmes autochtones (44 %) que de femmes non autochtones (25 %) avaient subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime au cours de leur vie.
La violence psychologique est la forme de VPI la plus couramment subie tant par les femmes autochtones que par les femmes non autochtones; toutefois, une proportion nettement plus élevée de femmes autochtones (60 %) que les femmes non autochtones (42 %) ont subi des violences psychologiques au cours de leur vie.
Les femmes autochtones ont été presque trois fois plus susceptibles d’être exploitées financièrement par un partenaire intime au cours de leur vie que les femmes non autochtones.
Il est également évident que le croisement de l’identité autochtone avec d’autres caractéristiques a une incidence sur l’expérience de VPI.
Les femmes autochtones LGBTQ2S sont plus susceptibles (86 %) de subir de la VPI au cours de leur vie que les femmes autochtones qui ne sont pas LGBTQ2S (59 %).
Les femmes autochtones handicapées sont plus nombreuses (74 %) à avoir subi de la VPI au cours de leur vie que les femmes autochtones non handicapées (46 %).
Les femmes autochtones sont plus exposées non seulement à de la violence de la part de partenaires intimes, mais également à la violence fondée sur le genre perpétrée par des personnes autres que des partenaires intimes.
Dans l’ensemble des provinces, plus d’une femme autochtone sur deux (50 % ou plus) a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’autres agresseurs au cours de sa vie, contre 44 % ou moins des femmes non autochtones.
Les taux de violence à l’encontre des femmes autochtones sont encore plus élevés dans les territoires.
Dans l’ensemble, les taux sont élevés lorsqu’on tient compte de la violence perpétrée par n’importe quelle personne (c’est-à-dire un partenaire intime ou un autre agresseur).
• Environ 6 femmes autochtones sur 10 (63 %) ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie, contre 45 % des femmes non autochtones.
• Entre 2009 et 2021, le taux d’homicide contre les femmes et les filles des Premières Nations, des Métis et des Inuits était six fois plus élevé que celui à l’encontre de leurs homologues non autochtones*.
• Il y a une crise nationale qui se poursuit chez les femmes, les filles et les personnes 2LGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Entre 1980 et 2012, « le nombre de cas déclarés à la police de femmes autochtones disparues et assassinées et de disparitions de femmes autochtones non résolues » sont au total de 1 181.**
Il se peut que le nombre réel de cas soit encore plus élevé, en raison de la possibilité d’une sous-déclaration ou de problèmes liés à la collecte de données.
* Cette conclusion est tirée de « Décisions rendues par les tribunaux dans les causes d’homicides de femmes et de filles autochtones, 2009 à 2021 » par Marta Burczycka et Adam Cotter, un article qui utilise les données de l’Enquête sur les homicides et de l’Enquête intégrée sur les tribunaux pénaux. Vous pouvez lire l’article complet ici.
** Ce constat est tiré de « Les femmes autochtones disparues et assassinées : un aperçu opérationnel national » (2014) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un rapport découlant d’une étude dirigée par la GRC lancée en 2013. Vous pouvez lire le rapport complet ici.
Services de soutien pour les peuples autochtones
Pour l’hébergement d’urgence, pour des programmes et pour du soutien pour les femmes autochtones qui subissent de la violence familiale ou de la violence entre partenaires intimes, veuillez communiquer avec le Nignen Women’s Shelter (Refuge pour femmes Nignen) au 1 (833) 644-3002 ou la Gignoo Transition House (Maison de transition Gignoo) pour sa ligne d’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1 800 565-6878, ou sa ligne d’écoute locale au 506 458-1224.
Il y a actuellement au Nouveau-Brunswick quatre travailleuses d’approche qui fournissent spécifiquement aux populations autochtones des services en matière de violence familiale. Elles desservent les zones géographiques suivantes :
St. Mary’s, Kingsclear, Oromocto - (506) 452-2760, cellulaire: (506) 230-0287
Première Nation de Tobique - (506) 273-5470, cellulaire: (506) 273-0724
Première Nation d’Elsipogtog - (506) 523-4747
Eel Ground, Burnt Church, Metepenagiag - (506) 626-1399
Le Elsipogtog Health & Wellness Centre (Centre de santé et de bien-être d’Elsipogtog) offre une gamme de services à la clientèle, y compris le Centre de crise d’Elsipogtog avec une ligne d’aide 24 heures sur 24 au 1 506 523-8260 ou au numéro sans frais 1 855 523-8260.
Le New Brunswick Aboriginal Peoples Council (NBAPC; Conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick) dirige un projet axé sur la communauté intitulé Looking Out For Each Other: Assisting Aboriginal families and communities when an Aboriginal woman goes missing (Les uns pour les autres : aider les familles et les communautés autochtones quand une femme autochtone disparaît). Le projet comprend de nombreuses ressources d’information, ainsi qu’une ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les familles peuvent appeler lorsqu’un être cher disparaît, afin de les aider à naviguer dans les différents systèmes. Vous pouvez appeler la ligne d’assistance au 1 833 664-3463.
Pour du soutien par rapport aux femmes, filles, personnes bispirituelles, transgenres et de genre diversifié + autochtones disparues et assassinées, il y a une ligne d’assistance nationale que vous pouvez joindre au 1 844 413-6649.
Pour des services de counseling accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut, les peuples autochtones peuvent partout au pays accéder à la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être au 1 855 242-3310 ou par le biais d’un clavardage en ligne sur leur site web.
Documents d’information sur la VF/VPI et les peuples autochtones
Rendez vous sur le site Web du Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) pour consulter un Répertoire des services à l’intention des victimes de violence dans les communautés des Premières Nations. Le SPEIJ-NB fournit également un certain nombre de ressources d’information sur la Prévention de la violence familiale dans les collectivités autochtones, notamment un guide sur les Ordonnances de protection d’urgence pour les couples vivant dans les réserves, un livret pour les femmes autochtones intitulé Créer des relations personnelles saines, et de nombreux documents tirés de Les sentiers de la guérison.
Consultez le site Web de l’Association des femmes autochtones du Canada pour des ressources et des programmes d’information en ligne. Les trousses de soutien (en anglais seulement) de l’AFAC peuvent vous aider à naviguer dans des sujets comme le logement pour les victimes de violence familiale ou le logement pour les animaux de compagnie. Le programme Safe Passage (Passage sûr) comprend des cartes indiquant les cas de femmes, filles, personnes bispirituelles, transgenres et de genre diversifié + autochtones disparues et assassinées, et des ressources communautaires partout au Canada, la possibilité de faire part d’une expérience dangereuse, ainsi qu’un centre de ressources comprenant des documents tels que « You Are Not Alone : a toolkit for Aboriginal women escaping domestic violence » (Vous n’êtes pas seule : une boîte à outils pour les femmes autochtones qui fuient la violence familiale).
La Commission d’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été créée en 2016. Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été publié en 2019 et comprend 231 appels à la justice.
En réponse au rapport final, le Plan d’action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré par un groupe de travail principal en collaboration avec le Cercle national des familles et des survivantes, ainsi que des partenaires contributeurs.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié Tisser nos voix ensemble : le cheminement du Nouveau-Brunswick vers la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones en 2023. Il s’agit de la réponse du Nouveau-Brunswick à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Pour en savoir plus au sujet des femmes, filles, personnes bispirituelles, transgenres et de genre diversifié + autochtones disparues et assassinées.
Ressources supplémentaires
Indigenous Women of The Wabanaki Territories (IWWT; Femmes autochtones des territoires abénaquis) est un organisme à but non lucratif qui propose des programmes, des ateliers, des ressources et des informations aux femmes et aux filles autochtones, ainsi qu’aux personnes 2ELGBTQQIA+ de diverses identités de genre des communautés abénaquises et urbaines.
Le Under One Sky Friendship Centre (Centre d’amitié un seul ciel) est un organisme à but non lucratif qui propose des programmes, du soutien, des formations et des informations pertinentes pour les peuples autochtones.
La Wabanaki Collection (Collection abénaquise) est un projet géré par le centre Mi’kmaq-Wolastoqey de l’Université du Nouveau-Brunswick qui fournit du matériel pour permettre aux éducateurs et au grand public de se familiariser avec les visions du monde, la culture, l’histoire et les traités des Abénaquis.
Pour obtenir une liste complète des ressources à la disposition des peuples autochtones ou pour en apprendre davantage sur les cultures autochtones, consultez le site du ministère des Affaires autochtones du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Pour obtenir des informations sur les services destinés aux peuples autochtones à travers le Canada, consultez le site Web de Services aux Autochtones Canada (SAC).
Notre engagement
L’Association contre la violence familiale du Nouveau-Brunswick (l’Association) est reconnaissante de se trouver dans ce qui se nomme aujourd’hui le Nouveau-Brunswick, qui constitue un territoire traditionnel non cédé des peuples Wolastoqiyik, Mi’kmaq et Passamaquoddy. Ce territoire est couvert par les « Traités de paix et d’amitié » que les nations Abénaquis ont d’abord conclus avec la Couronne britannique en 1725. Les traités ne parlaient pas de cession de terres et de ressources, mais reconnaissaient en réalité les titres des Wolastoqey, des Mi’kmaq et des Passamaquoddy et établissaient les règles de ce qui devait devenir une relation permanente entre nations.
L’Association s’est engagée à soutenir les femmes et les filles, ainsi que les membres autochtones de la communauté 2ELGBTQIA+, pour lutter contre la violence grave à laquelle ces personnes sont confrontées, ainsi que les centres d’hébergement pour femmes autochtones qui les soutiennent. Notre travail consiste à sensibiliser à la violence qui se maintient et aux ressources disponibles, en offrant des possibilités de formation au personnel du secteur VF/VPI et à veiller à ce que les voix autochtones soient entendues dans le cadre de nos activités. L’Association continuera de travailler avec les communautés autochtones, à apprendre d’elles et à plaider pour la fin de la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones.